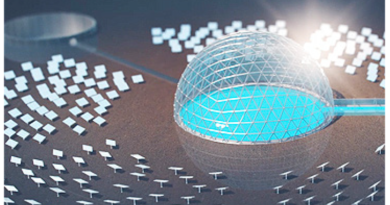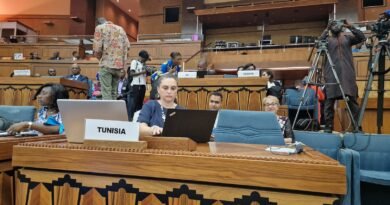Les incendies, facteur naturel pour le renouvellement des forêts
Bien que les incendies de forêt soient souvent perçus comme des catastrophes écologiques, ils jouent en réalité un rôle essentiel dans le cycle de vie de nombreuses forêts, notamment dans les zones méditerranéennes. Chaque année, environ 350 millions d’hectares de terres dans le monde sont affectés par les incendies, soit près de 2,7% de la surface terrestre globale, incluant forêts, prairies et savanes. Ces feux, qu’ils soient naturels ou d’origine humaine, participent à une dynamique naturelle nécessaire à la biodiversité dans de nombreux écosystèmes.
Dans le bassin méditerranéen, les incendies détruisent en moyenne entre 500 000 et 700 000 hectares de forêt par an. Ces forêts, notamment celles composées de pin d’Alep, de chêne-liège et d’autres essences méditerranéennes, sont adaptées à ces phénomènes. En effet, plusieurs espèces ont développé des mécanismes spécifiques : par exemple, leurs graines nécessitent la chaleur du feu pour s’épanouir, facilitant ainsi la germination et la régénération des peuplements. L’action du feu débarrasse la forêt de la végétation morte et encombrante, libère des nutriments dans le sol en brûlant la matière organique, et enrichit ainsi la terre pour favoriser la croissance des nouvelles plantes. La régénération naturelle dans ces zones peut s’étendre de cinq à vingt ans selon la sévérité des incendies et les conditions climatiques locales.
Le brûlage dirigé, reconnu internationalement comme un outil d’aménagement forestier, joue un rôle clé dans la gestion durable des forêts. Selon l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), « Le brûlage dirigé est un outil d’aménagement forestier qui permet non seulement de réduire la quantité de combustibles dangereux mais aussi d’améliorer l’habitat de la faune sauvage. C’est une opération complexe, à utiliser avec prudence, qui doit être conduite dans des conditions strictes et maîtrisées ». Cette technique, bien maîtrisée, permet de prévenir les feux catastrophiques tout en favorisant la biodiversité locale.
Le sol reçoit une couche de cendres riches en minéraux, stimulant la croissance des jeunes plants. La lumière pénètre davantage dans la forêt détruite, offrant un espace propice à des espèces vivaces et à de jeunes arbres souvent vigoureux. Le feu élimine aussi les espèces les plus compétitives qui bloqueraient la lumière et l’espace, ainsi la diversité des espèces est favorisée. Certaines essences stockent leurs graines sous forme de cônes fermés, qui ne libèrent leur contenu qu’au contact de la chaleur, assurant ainsi une reproduction synchronisée immédiatement après le passage du feu. Ce processus naturel garantit que la forêt se renouvelle avec un mélange d’espèces adaptées aux conditions environnementales du milieu.
Un exemple marquant de la double nature des incendies est celui des feux de brousse australiens de la saison 2019-2020. Cette catastrophe écologique a ravagé environ 18,6 millions d’hectares, dont 12,6 millions de forêts, avec plus de 15 000 incendies recensés, principalement en Nouvelle-Galles du Sud et Victoria. Malgré ces pertes considérables, les écosystèmes australiens ont démontré une capacité remarquable à se régénérer. Des espèces comme les eucalyptus, qui possèdent des mécanismes d’adaptation liés au feu, ont vu leurs graines stimulées par la chaleur, permettant une renaissance progressive des forêts et souvent un renforcement de la biodiversité. Ce cas illustre comment, avec une gestion adaptée, les incendies, même massifs, peuvent devenir un facteur clé de renouvellement forestier, renforçant la résilience des écosystèmes face aux changements climatiques futurs.
En Tunisie, les incendies de forêt sont fréquents et affectent chaque année environ 15 000 hectares, surtout dans les régions du nord et du centre. Les forêts de pin d’Alep et de chêne-liège, très présentes localement, bénéficient d’une résilience naturelle et d’une capacité de régénération grâce à des mécanismes similaires à ceux observés ailleurs dans le bassin méditerranéen. Cependant, en Tunisie, cette régénération est souvent freinée par des facteurs limitants tels que la sécheresse, le surpâturage, ou encore la répétition trop proche des incendies. Pour supporter le renouvellement forestier, les autorités ont mis en place des programmes de reforestation assistée, ayant permis de replanter près de 5 000 hectares depuis 2023, ciblant en priorité les zones les plus vulnérables. Elles encouragent également la pratique des brûlages dirigés, des feux contrôlés à faible intensité destinés à réduire la biomasse inflammable. Cette méthode a permis de diminuer la superficie brûlée de près de 30% lors des dernières campagnes, contribuant de manière significative à la prévention des incendies catastrophiques.
M. Sahbi Ben Dhiaf, directeur de la conservation des forêts au ministère de l’Agriculture, a souligné récemment en juillet 2025, l’importance de la vigilance face aux incendies : « Une simple étincelle peut provoquer une grande catastrophe. En 2024, 246 incendies ont ravagé 733 hectares, un chiffre normal par rapport à la saison, reflétant l’efficacité des unités d’intervention. Toutefois, 95% de ces incendies sont d’origine humaine, entre actes criminels délibérés ou négligences. La vigilance et la responsabilité de chacun sont essentielles pour protéger notre patrimoine forestier ».
Les brûlages dirigés, largement utilisés dans des pays méditerranéens comme la France et la Tunisie, consistent à allumer des feux sous contrôle strict dans des conditions climatiques et topographiques maîtrisées. En Corse, l’application de ces techniques a entraîné une réduction de 40% de la surface brûlée dans les zones pilotes sur la dernière décennie. Ces « feux sains » limitent la montée en intensité des incendies accidentels et favorisent la pérennité de la biodiversité et la dynamique naturelle de renouvellement des forêts méditerranéennes.
Ainsi, les incendies incarnent une dualité majeure : ils peuvent être destructeurs, mais aussi indispensables à la santé écologique des forêts. Le défi environnemental et sylvicole est de trouver un juste équilibre entre prévention des incendies incontrôlés, souvent aggravés par le changement climatique, et l’utilisation raisonnée des feux pour encourager la régénération naturelle. Par une gestion durable alliant surveillance, reforestation assistée et brûlages contrôlés, il est possible d’accompagner ce cycle naturel afin de préserver les écosystèmes forestiers pour les générations futures.