COP30 : un bilan mitigé peut-il suffire face à l’urgence climatique ?
La 30e Conférence des Nations Unies sur le climat (COP30), qui s’est tenue du 10 au 22 novembre 2025 à Belém au Brésil, a réuni près de 200 pays dans une atmosphère tendue, marquée par un incendie mineur survenu jeudi 20 novembre dans les pavillons de la conférence. Après des négociations prolongées au-delà du calendrier initial, un accord a minima a été adopté le samedi 22 novembre, préservant le cadre multilatéral sans avancer sur les énergies fossiles ni répondre pleinement à l’urgence climatique. Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a salué un triomphe du multilatéralisme depuis Johannesburg, où se tenait le G20, mais de nombreuses délégations, dont l’Union européenne et la France, ont exprimé leur déception face à un texte jugé insuffisamment ambitieux.
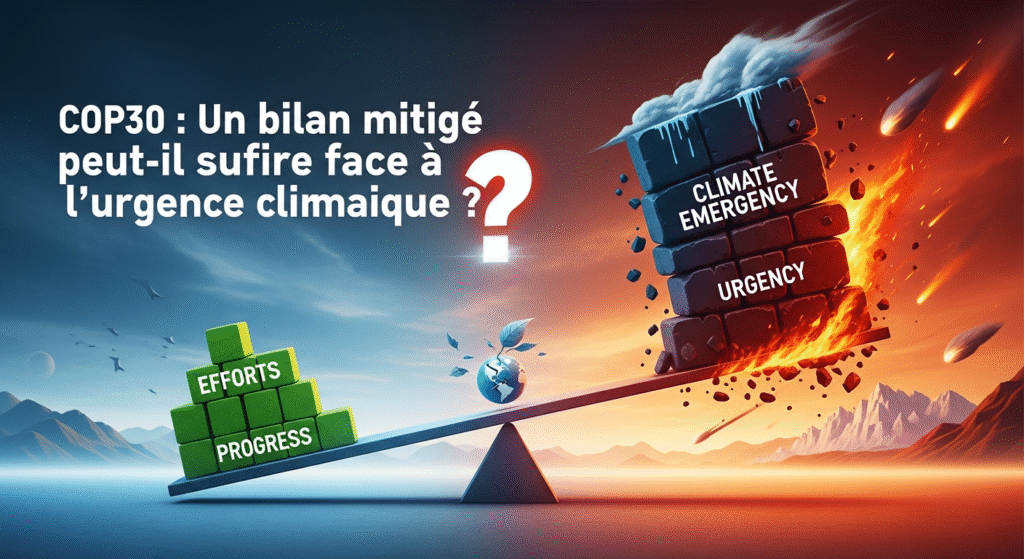
Belém, porte d’entrée de l’Amazonie, accueillait pour la première fois une COP, symbolisant l’engagement brésilien pour la préservation de la forêt tropicale. Les débats ont porté sur quatre points épineux : les financements pour l’adaptation, les plans nationaux de réduction des émissions (CDN), le commerce mondial et la transition énergétique. Dès l’ouverture le 10 novembre, plus de 80 nations, soutenues par Lula, ont plaidé pour plus d’ambition, tandis que la Chine, la Russie, l’Arabie saoudite et certains pays en développement priorisaient les fonds immédiats sur la sortie des fossiles. Les négociations, menées en huis clos par la présidence brésilienne dirigée par André Corrêa do Lago, ont visé à éviter les exclusions, mais ont révélé des fractures profondes entre pays riches et vulnérables.
L’un des rares succès concrets concerne les financements climatiques, avec un engagement à tripler d’ici 2035 les aides pour l’adaptation des pays en développement, passant de 40 à 120 milliards de dollars par an par rapport à 2025. Cette enveloppe cible les petits États insulaires et les nations les moins avancées, en première ligne des impacts comme les inondations et les sécheresses. Bien que non contraignante, cette promesse marque une brèche dans les résistances des pays développés, répondant aux priorités des économies émergentes qui manquent de ressources pour une transition carbone ou une adaptation immédiate.
Le texte final, publié sur le site de la CCNUCC, réaffirme le multilatéralisme comme pilier des efforts globaux et consacre la science comme guide des actions futures. Il exhorte tous les États à accélérer leurs CDN pour respecter l’Accord de Paris, tout en instaurant un « dialogue » inédit sur le commerce mondial, une priorité chinoise contre les taxes carbones aux frontières. En parallèle, le Brésil a lancé une feuille de route volontaire pour la sortie des fossiles, non intégrée à l’accord mais annoncée en plénière pour répondre aux demandes européennes.
Contrairement à la COP28 de Dubaï en 2023, qui évoquait une « transition hors des énergies fossiles », le texte de Belém n’en fait aucune mention explicite, malgré les pressions de la France et de l’UE. La délégation française a regretté « l’insuffisante ambition sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre », tandis que le commissaire européen Wopke Hoekstra a menacé de quitter les pourparlers et qualifié l’accord de décevant. Ce blocage, mené par les grands producteurs fossiles et certains pays en développement, entache le bilan, alors que le Brésil promettait de ne pas esquiver le débat.
Pour résumer les points saillants de cet accord a minima, Belém laisse un bilan contrasté, des avancées financières arrachées pour les plus vulnérables, une réaffirmation des principes multilatéraux, mais un silence assourdissant sur les énergies fossiles. Ces éléments, bien que précieux, interrogent leur suffisance face à l’urgence climatique qui s’accélère
1- Des promesses de financement
Les pays les plus vulnérables quittent Belém avec une promesse chiffrée. Après de rudes discussions, les parties sont parvenues à s’entendre sur un objectif clair d’augmentation des fonds dédiés à l’adaptation. Cette enveloppe est cruciale pour les petits États insulaires et les pays les moins avancés, en première ligne face aux impacts du dérèglement climatique. Une brèche dans la forteresse des négociations financières, souvent bloquées par les pays développés.
2- Réaffirmation des principes fondamentaux
Le texte adopté, consultable sur le site de la CCNUCC, réaffirme explicitement le soutien au multilatéralisme climatique et reconnaît le rôle de la science pour guider l’action climatique. Il appelle également tous les États à poursuivre la mise en œuvre de leurs plans climatiques nationaux (CDN).
3- Les énergies fossiles évincées du texte final
C’était pourtant l’un des grands enjeux de cette COP. Malgré un plaidoyer porté par la France et l’Union européenne, le lancement de feuilles de route pour une sortie progressive des énergies fossiles n’a pas trouvé sa place dans l’accord final.
Les déclarations de la délégation française, teintées d’amertume, ne laissent planer aucun doute sur cette déconvenue majeure. « La France a regretté l’insuffisante ambition du texte final sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre »
Si le dialogue diplomatique a été préservé et les financements climatiques partiellement sécurisés, l’échec à acter le début de la fin des énergies fossiles entache durablement le bilan de cette COP30. Entre les promesses d’adaptation arrachées pour les plus vulnérables et l’incapacité à s’attaquer à la racine du problème, la conférence laisse une empreinte de compromis inabouti.




